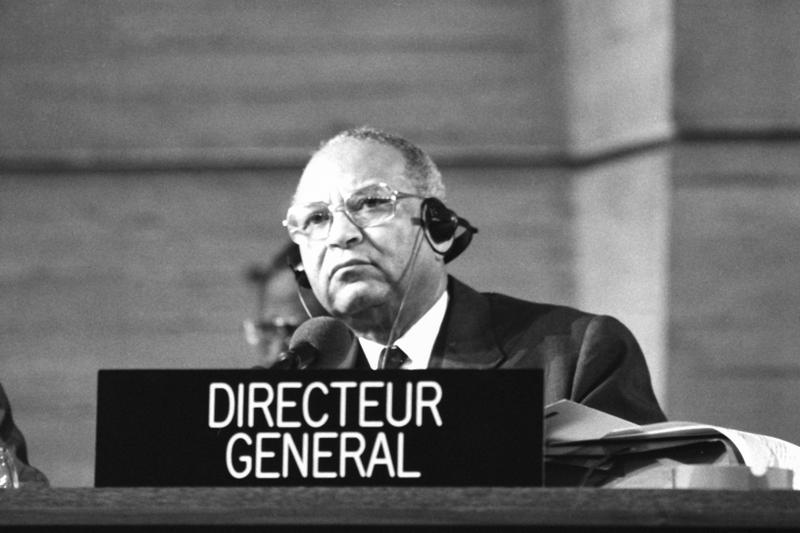Moi… Tirailleur sénégalais
Un récit autobiographique
 | |||
| Collection : Harmattan Sénégal |
Ce récit autobiographique relate la vie de Mamadou Niang, originaire de Rufisque, Sénégal. Enrôlé dans l’armée française en 1949, il reçoit une formation militaire à Bamako, puis se spécialise en finances en France. Il participe aux guerres d’Indochine et d’Algérie. Après sa retraite militaire en 1969, il rentre au Sénégal pour travailler à l’ASECNA jusqu’en 1989. En parallèle, Niang est un sportif accompli, pratiquant le judo à haut niveau.
Son histoire, marquée par ses contributions militaires et civiles, témoigne d’une vie riche et dédiée au service de son pays et de la communauté.
Pour en savoir plus :
La préface du roman, par Samba DIOP, Professeur titulaire des universités, Oslo, Norvège :
Ce livre, ce court récit autobiographique que le lecteur a entre les mains, est riche d'enseignements ; ce récit ne constitue pas à proprement parler des « Mémoires » si l’on définit ce genre comme étant une relation écrite, sur une longue période et dont l’auteur, en l’occurrence Mamadou Niang, est à la fois acteur, auteur et témoin. Ainsi, pour être plus circonstancié, l’auteur puise dans sa mémoire et dans ses souvenirs afin de relater les faits saillants qui ont marqué sa vie militaire et professionnelle. À proprement parler, M. Niang n’est pas un tirailleur sénégalais mais, plutôt, un militaire bien formé avec un niveau d’éducation très élevé ; il s’est affublé cette appellation de « tirailleur », sûrement, par esprit et solidarité de corps.
Je suis en train de sauter le pas. II faut commencer par le commencement. Mamadou Niang, plus connu sous le sobriquet de Doudou Niang, a fait une brillante carrière dans l’armée française. un curriculum vitae qui a démarré vers la fin des années 1940, sous l'époque coloniale. En ce temps, l'empire colonial français était en train de subir les contre-coups de la décolonisation en Asie, en Afrique et ailleurs.
Qu'importe, le Sénégal avait les quatre communes de Dakar (créée en 1887), Gorée (1872), Rufisque (1880) et Saint-Louis (1872). Ainsi Gorée et Saint-Louis sont les plus anciennes des communes ; en plus, Saint-Louis a l’insigne honneur d'avoir été la capitale de l'AOF (Afrique Occidentale Française).
Pour faire court, les originaires de ces communes étaient exemptés des rigueurs du système de l'indigénat. Cependant, ils n’avaient pas tous les droits des citoyens français de plein exercice. C'est grâce à la loi Blaise Diagne (du nom du premier député noir africain à l’Assemblée nationale française) en date du 29 septembre 1916 que les natifs des quatre communes ont acquis la pleine citoyenneté française. II a fallu attendre 1946 avec la Loi Lamine Guèye (premier avocat du Sénégal) pour que l'indigénat soit complètement aboli et, de ce fait, étendre la citoyenneté à tous les habitants des colonies françaises.
En tant que natif de Rufisque, Mamadou Niang a été enrôlé dans l’armée française vers la fin des années 1940 afin d'accomplir son service militaire. Ainsi débuta une carrière riche en rebondissements, défis et accomplissements ; le jeune conscrit est aussitôt envoyé à Bamako dans l'ancien Soudan français (actuel Mali). Ensuite, la hiérarchie militaire ayant remarqué que Niang était un élément très doué et avait de grandes capacités intellectuelles, décision fut prise de l’envoyer à Nantes en France afin d continuer une formation professionnelle dans le domaine financier et comptable mais toujours au sein de l'armée. Dans ce livre, Niang nous fait entrevoir tout un pan de l’histoire coloniale française en Afrique noire.
Ce récit enthousiasmant me fait aller trop vite en besogne ; je me dois donc de revenir un peu en arrière et relever comment Doudou Niang narre sa jeunesse à Rufisque ainsi que sa scolarité menée entre Rufisque et Dakar. II faut aussi inclure l'épisode sur sa vie d'adolescent, passée à chaparder des mangues, à vadrouiller dans la brousse ou à aller à la plage, etc., une enfance insouciante que la plupart des générations précédentes ont connue ; il faut noter que dans les années 1940 jusqu'aux années 1980, les villes du Sénégal étaient semi-urbaines et la campagne (la brousse) n’était jamais loin ; cependant. de moins en moins de jeunes habitant les villes font l'expérience formatrice d'une telle enfance à cause des transformations sociales et de l'urbanisation galopante. Surtout. Niang était un amoureux de la boxe et s’entrainait avec assiduité et sérieux sous la direction d'un coach français répondant au nom de Monsieur LeGrijoix ; d’ailleurs le récit s’ouvre sur cet épisode ayant trait au pugilat. Plus tard, Niang va s’adonner au judo jusqu'à brillamment atteindre le niveau de ceinture noire 2ème dan. Sans compter les riches traditions culturelles rufisquoises qu'il évoque, telles que la lutte que relate l'auteur ; Rufisque étant au bord de l'océan Atlantique, forcément, le sujet de la pêche artisanale allait enrichir le récit, en plus de l'évocation des régates, ces fêtes annuelles de courses de pirogues.
Mamadou Niang va bourlinguer à travers le monde et est l'un des rares Sénégalais vivants à avoir été témoin de deux guerres coloniales : Indochine (Vietnam) et Algérie. Il a eu aussi le privilège et l'opportunité d’avoir travaillé au sein du service de la Direction centrale du Commissariat de l'Air, en d'autres termes, un service d'inspection de l’armée. II va sans dire que peu de soldats ont l’occasion de servir dans ce prestigieux service. Cette affectation l’a amené à beaucoup voyager dans l’Hexagone ainsi que dans les territoires où la France avait des bases et casernes militaires. Niang a reçu de nombreuses décorations militaires. Lors de son séjour parisien, Niang eut l’occasion de fréquenter l’université afin de parfaire sa formation.
En 1969, après avoir bouclé le nombre d'années requises afin de prendre sa retraite de l’armée, Niang rentre au Sénégal (au pays natal, pour paraphraser le grand poète de la Négritude, le Martiniquais Aimé Césaire) où il obtient un poste en tant que chef de service administratif et financier à l’ASECNA avec le statut de coopérant français avant de prendre une retraite définitive bien méritée le 1er Juin 1988. Après avoir passé tant d'années à l’étranger, Niang se devait de se réacclimater. Il ne se contentera pas seulement d'assumer ses nouvelles hautes responsabilités à l’ASECNA car il prendra activement part aux activités de renaissance sociale, sportive, culturelle et économique de sa ville natale de Rufisque.
II est temps de conclure et de ne pas tout raconter et, ainsi, laisser le soin au lecteur de lire ce livre séminal. Ce n’est pas par hasard que j’utilise le terme « séminal » car, en observant le riche parcours de Doudou Niang, non seulement on se rend compte qu’il a semé la bonne graine, mais en plus il sert de modèle aux générations actuelles, en plus de baliser la voie pour la postérité. Les générations sénégalaises et africaines actuelles et à venir ont besoin du genre de personne telle que Mamadou Niang qui, à la fois, inspire et démontre qu’une vie bien remplie, ancrée dans le sérieux, l’éducation, les études et la formation, la discipline, le courage, la volonté, l'honnêteté, la persévérance. la droiture. la patience, la foi, l'effort constant dans le travail bien fait, l’assumation de ses responsabilités, enfin et surtout, la famille, une telle vie vaut bien la peine d’être vécue pour dire le moins.
Je recommande vivement cet ouvrage riche en enseignements, somptueux en aventures, découvertes, bildung (formation) et, enfin, plein de pépites de sagesse. Puissent ce livre et son contenu susciter une saine émulation au sein de la jeunesse sénégalaise et africaine. C'est mon vœu le plus ardent.